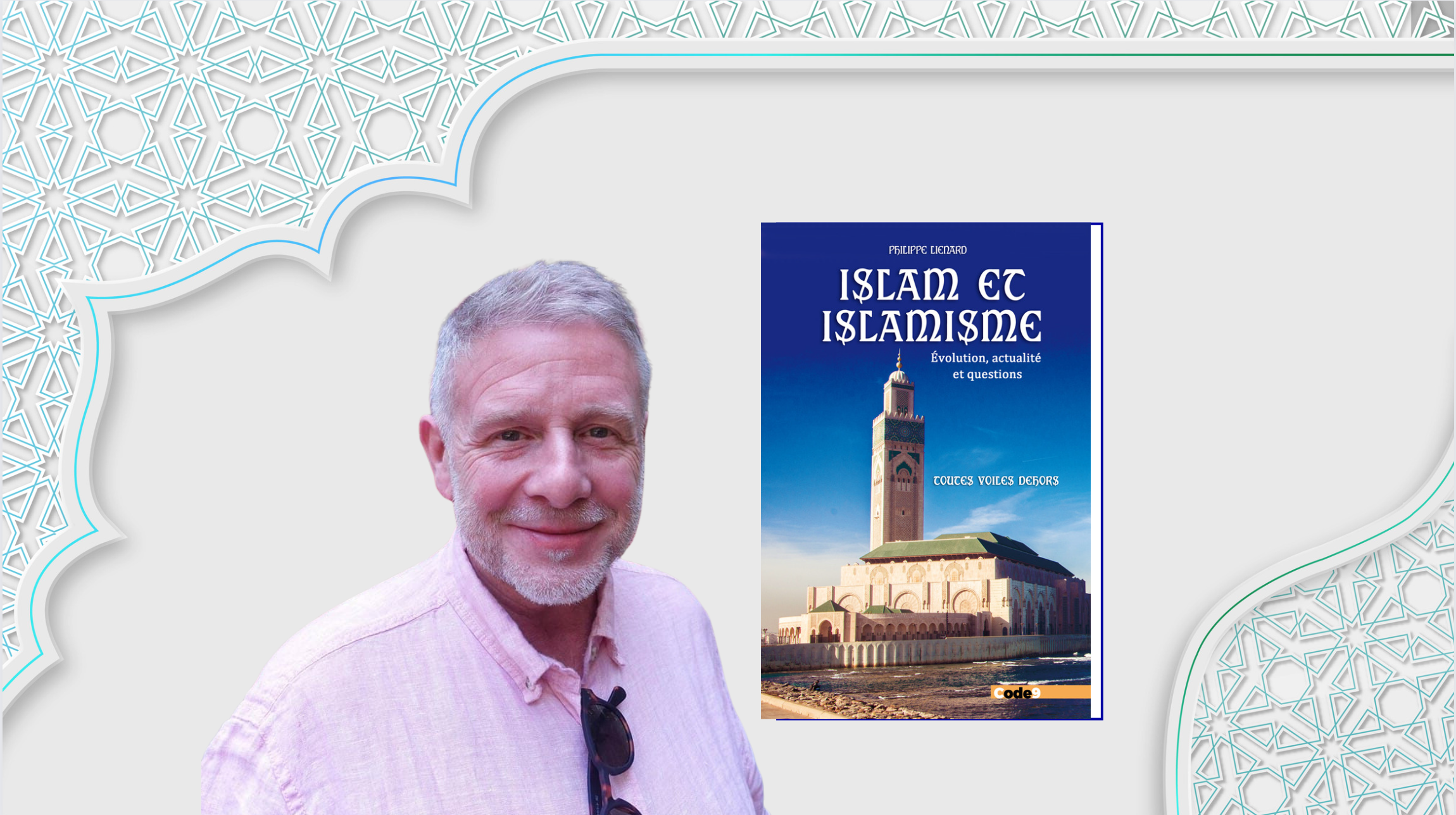Le cadre juridique de l’Union européenne ne reconnaît pas la catégorie de « religion traditionnelle ». Cela signifie que ni les institutions européennes ni les réseaux interreligieux influents – y compris les plateformes telles que Religions pour la paix – ne peuvent restreindre l’accès à l’adhésion, au dialogue ou à la coopération selon qu’une communauté est considérée comme « traditionnelle », « historique » ou culturellement familière. Cette distinction n’a aucun fondement dans le droit de l’UE et contredit les principes fondamentaux d’égalité de traitement et de non-discrimination.
La question de savoir qui est invité dans les dialogues institutionnels européens sur la religion et la conviction – notamment dans le cadre Article 17 TFUE – est devenu un sujet de surveillance croissant. Une analyse récente met en évidence un fait simple mais conséquent : Le droit de l’UE ne reconnaît pas des concepts tels que « église traditionnelle », « religion traditionnelle », « religion historique » ou « religion culturelle ». Aucun de ces termes n’apparaît dans l’article 17 du TFUE, l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux, le règlement 1049/2001, la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ou les lignes directrices de l’Agence des droits fondamentaux de l’UE sur la liberté de religion ou de conviction.
Aucune base légale pour la hiérarchie religieuse
L’architecture de non-discrimination de l’UE est explicite : les autorités publiques ne peuvent pas faire de différence entre les communautés en fonction de leur ancienneté, de leur niveau d’établissement ou de leur familiarité sociale. Comme le dit une formulation juridique largement utilisée par les experts : L’UE ne dispose d’aucune base juridique pour traiter les communautés différemment selon qu’elles sont ou non considérées comme « traditionnelles ». Une telle différenciation serait incompatible avec la Charte et avec l’approche non hiérarchique de la religion exigée par le droit de l’UE.
Cette clarté crée une conséquence contraignante pour les institutions européennes. Si la Commission européenne ou tout autre organe de l’UE utilise le terme « traditionnel » comme justification pour exclure certaines communautés religieuses ou philosophiques de la consultation, de la reconnaissance ou du dialogue structuré, cela :
- violer l’article 21 du CFR (non-discrimination fondée sur la religion ou les convictions),
- enfreindre le principe d’égalité de traitement dans le droit de l’Union européenne,
- contredire le modèle non hiérarchique inscrit à l’article 17 du TFUE,
- en contradiction avec la jurisprudence de la CEDH affirmant une protection égale pour les religions majoritaires et minoritaires.
En bref, l’UE ne peut défendre aucune pratique qui place les religions « traditionnelles » au-dessus des autres sans contredire son propre ordre juridique.
Implications pour les réseaux interconfessionnels et les plateformes de la société civile
Le débat ne s’arrête pas aux institutions européennes. Cela affecte également la légitimité des grandes organisations interconfessionnelles et multireligieuses actives dans toute l’Europe. Des plateformes internationales telles que Religions pour la paix – aux côtés d’organisations similaires qui jouent un rôle important dans le dialogue politique – exercent une influence non seulement par leur plaidoyer mais aussi en décidant qui fera partie de leurs membres.
Les juristes soulignent que ces organisations ne peuvent pas refuser l’accès, la participation ou la coopération au motif qu’une communauté n’est « pas traditionnelle ». Bien qu’ils soient des acteurs indépendants de la société civile, ils opèrent dans un environnement de droits fondamentaux de l’UE, en particulier lorsqu’ils participent à des programmes financés par l’UE, aux consultations de la Commission ou aux dialogues au titre de l’article 17.
Cela fait partie d’une préoccupation plus large documentée par les observateurs de la société civile et par plusieurs communautés à travers l’Europe : certains réseaux confessionnels s’appuient implicitement sur la familiarité historique comme outil de contrôle informel. Pourtant, de telles distinctions, une fois introduites dans les processus européens, deviennent juridiquement intenables.
Une insistance croissante sur l’égalité de traitement
Partout à Bruxelles, de plus en plus d’organisations pointent du doigt ce problème structurel. L’European Times a été approché par des communautés dénonçant un traitement inégal de la part des agences et des fonctionnaires de l’UE, fondé sur le fait qu’elles ne sont pas assez traditionnelles, comme si la tradition était quelque chose qui n’a jamais évolué, créant des obstacles à la participation équitable des communautés religieuses plus petites ou moins dominantes dans les affaires de l’UE, en particulier en ce qui concerne la transparence et le dialogue structuré.
Les parties prenantes soutiennent que s’appuyer sur la familiarité culturelle pour déterminer l’éligibilité sape ce que l’UE elle-même promeut : l’inclusion, le pluralisme et une conception civique de la liberté religieuse. Plusieurs analystes préviennent que si la Commission européenne devait un jour approuver explicitement un critère de « religion traditionnelle », cela exposerait l’institution à des contestations judiciaires.
Vers une approche juridique de la diversité religieuse
Le message des cadres juridiques est sans équivoque : les religions et les communautés de croyance – qu’elles soient anciennes ou nouvelles, majoritaires ou minoritaires, familières ou inconnues – doivent être traitées sur un pied d’égalité lorsqu’il s’agit de l’engagement de l’UE. La tradition est peut-être une catégorie sociologique, mais elle n’est pas juridique.
Alors que l’UE continue d’étendre son travail sur les droits fondamentaux, la cohésion sociale et la coopération avec la société civile, ce principe devient central. Cela détermine non seulement la manière dont la Commission doit structurer ses dialogues, mais également la manière dont les plateformes de la société civile opérant dans l’espace européen doivent garantir l’équité, la transparence et l’ouverture.
Publié à l’origine dans The European Times.