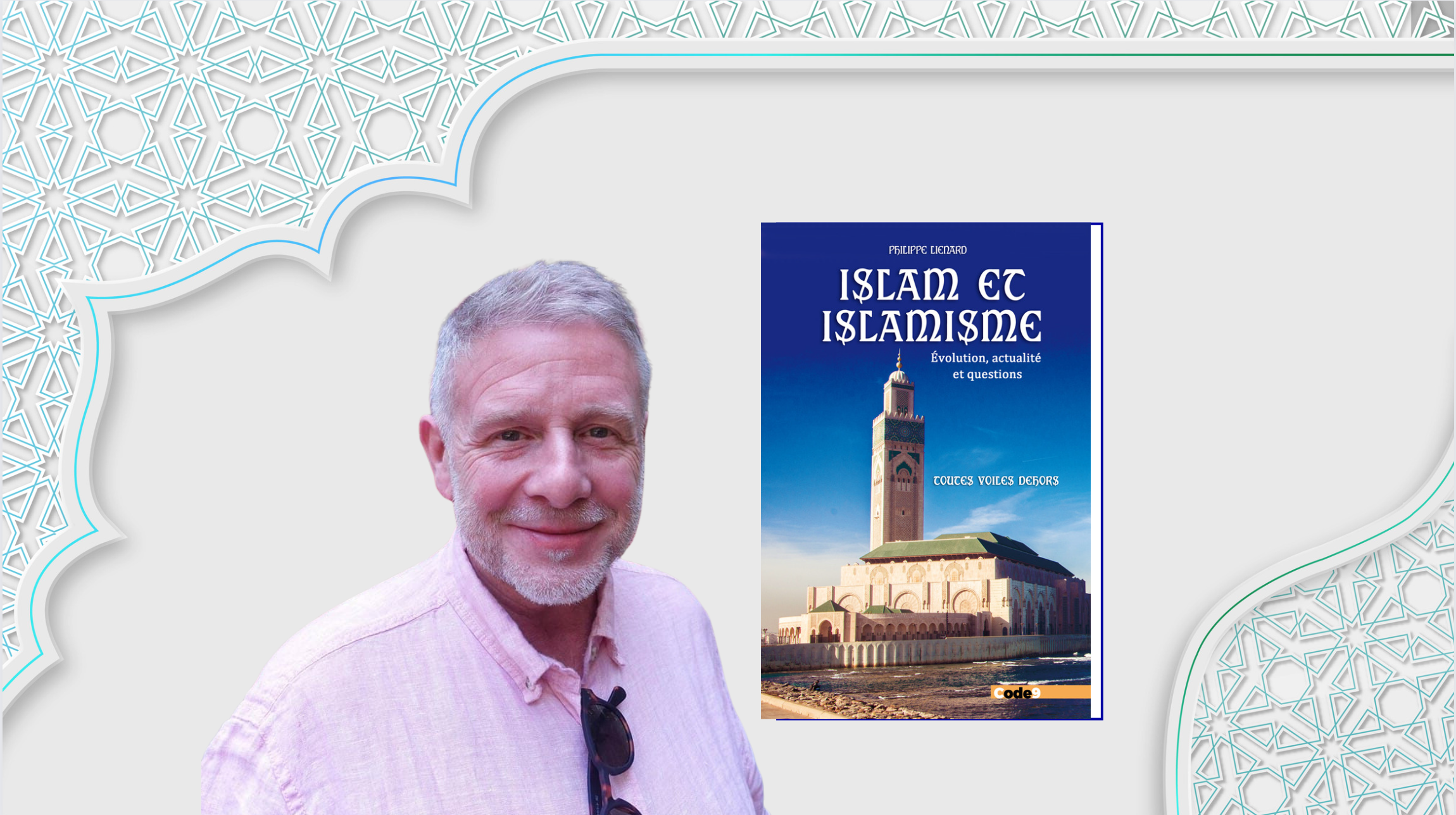Olukemi Ibikunle prit une profonde inspiration. Le travail lui convenait parfaitement mais l’emmènerait loin de sa famille à Lagos, au Nigeria. Ensuite, la chef de projet de 38 ans a fait ce que tout planificateur méticuleux ferait : elle a appelé chez elle.
« J’ai parlé à mon mari et il m’a dit : ‘Pourquoi me demandes-tu ? Vas-y, vas-y ! Dis-leur oui !' »
Son enthousiasme la réconfortait. Mais comment pourrait-il se débrouiller tout seul, argumenta-t-elle. Leurs deux enfants n’avaient que sept et dix ans. Il répliqua avec une seule question désarmante. « Ces enfants dont vous parlez… pouvez-vous me dire leur nom de famille ? Elle l’a fait. «C’est mon nom», répondit-il. « Laissez-les-moi. »
Olukemi Ibikunle, 43 ans, agente pénitentiaire du Nigeria, est la lauréate 2025 du Prix Trailblazer des Nations Unies pour les femmes agents de justice et d’administration pénitentiaire.
Architecte de la dignité
Nous étions en 2020 et Kemi, comme on l’appelle, s’était rendue indispensable au sein de l’administration pénitentiaire du Nigeria.
Lorsqu’un toit fuyait, qu’un mur se déformait ou qu’un bloc devait être conçu à partir de zéro, c’était elle que les gens appelaient. Dans l’État de Lagos, elle a supervisé cinq centres de détention abritant près de 9 000 détenus – ce qui n’est pas une mince affaire dans un domaine encore largement dominé par les hommes.
Le travail était impitoyablement spécifique, du genre à mettre en valeur les atouts du géologue pragmatique de formation : pas de fenêtres en verre ni de bassins en céramique susceptibles de se briser en armes ; barres renforcées pour une lumière sans risque.
« Nous apportons l’équilibre entre le respect de la dignité des personnes et la sécurité », a-t-elle déclaré. Même dans un quartier pénitentiaire, les toilettes doivent être privées. « Nous utilisons ce que nous appelons une ‘porte naine’ : je peux voir vos pieds et elle est couverte jusqu’au cou, donc je peux savoir si vous essayez de vous suicider. »
Cet équilibre était exactement ce que recherchait l’ONU. MONUSCOson opération de maintien de la paix en RDC, recherchait quelqu’un capable de franchir la frontière entre la sécurité et les droits de l’homme. « La compétence n’a pas de sexe », a-t-elle déclaré, s’exprimant avec le calme de quelqu’un qui a vu le béton prendre en temps réel.
Kemi a atterri à Kinshasa, la capitale congolaise, avec une mission qui, sur le papier, semblait administrative : contribuer à la réforme du système pénitentiaire en difficulté du pays. En pratique, cela signifiait repenser le paysage quotidien de l’incarcération dans un État post-conflit – tuyau par tuyau, porte par porte.
Changer d’avis
La réforme des prisons, elle le savait, devait commencer par des plans d’étage. L’équipe pénitentiaire de la MONUSCO s’est entretenue avec les autorités nationales pour défendre les Règles Mandela et les Règles de Bangkok – des normes internationales appelant à un traitement humain des prisonniers et à des pratiques de détention sensibles au genre. Mais ils se sont heurtés à de la résistance et à une vision étroite de ce que pourrait être une prison.
« Ils ne voyaient pas pourquoi nous devions inclure une bibliothèque ou un atelier dans la conception », se souvient Kemi. Elle a donc essayé une approche différente. Lorsque les prisons disposent de centres sportifs, explique-t-elle, les détenus sont en meilleure santé car ils exercent leur corps. « Et avec une bibliothèque », a-t-elle ajouté, « ils peuvent passer leur temps à lire au lieu de réfléchir à la façon de s’évader. »
Le message a finalement été compris. Elle et ses collègues ont rédigé un plan pour de nouvelles installations à l’échelle nationale et ont cartographié celles existantes, décidant lesquelles réhabiliter et lesquelles radier.
En cours de route, elle a insisté sur la construction de prisons séparées pour les femmes. « Ne placez pas seulement un quartier pour femmes dans une prison pour hommes », a-t-elle déclaré – c’est une recette pour exposer les femmes à l’exploitation et à la violence sexuelles. Lorsqu’une séparation complète n’était pas possible, elle a réclamé des clôtures et des couloirs indépendants.
Olukemi Ibikunle (au centre) organise un atelier de couture pour soutenir la réintégration des femmes détenues dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC).
Briser le moule
Sur le terrain, dans un premier temps, Kemi a balayé les commentaires sexistes rituels. Qui était cette « petite fille » qui voulait voir les reçus, inspecter les barres d’armature, remettre en question le rapport sable/ciment et vérifier les qualifications des ouvriers ?
Son yoruba natal – et même son anglais nigérian – ne lui étaient d’aucune utilité. Elle a appris le français technique à la volée – armatures, agglo, dalles – et a utilisé le répertoire de prix congolais pour dégonfler les offres rembourrées. «C’est surfait», disait-elle. « Nous pouvons réduire ce budget. »
Un site était censé être entièrement climatisé, mais le constructeur s’est présenté avec des ventilateurs sur pied. « J’ai sorti le document de projet… trois climatiseurs« , se souvient-elle en traçant une ligne dans l’air, comme elle le faisait alors, avec son stylo. Affaire classée. Finalement, lorsque les entrepreneurs ont appelé Kinshasa pour se plaindre, ils ont eu la même réponse: « Parlez à Kemi ».
Quand les rebelles sont arrivés
En 2023, Kemi avait été déployé à l’est, dans la province du Sud-Kivu. Dans la ville de Kabare, elle a supervisé la construction d’un centre de haute sécurité d’une valeur de 850 000 dollars, conçu pour détenir des « personnes difficiles », dont beaucoup sont liées à des groupes armés. C’était un projet à grande échelle. Elle a supervisé le site jour après jour, parcourant 20 kilomètres dans chaque sens depuis Bukavu, la capitale provinciale.
Puis, en janvier, la milice M23 a lancé une offensive majeure dans la région. En vertu d’un accord avec Kinshasa, la MONUSCO avait retiré ses soldats de maintien de la paix du Sud-Kivu l’année précédente, ne laissant en place que son équipe pénitentiaire.
Les troupes de l’ONU sont restées stationnées uniquement dans les provinces voisines du Nord-Kivu et de l’Ituri. Au moment où les rebelles dirigés par les Tutsis atteignirent la périphérie de Bukavu, Kemi était le seul survivant de la mission.
L’évacuation du personnel étranger a été chaotique. « Nous avons dû traverser des frontières terrestres sans aucune logistique de l’ONU, chacun trouvant sa propre voie de sortie, d’une manière ou d’une autre », a-t-elle déclaré.
Les combattants du M23, soutenus par le Rwanda voisin – bien que Kigali l’ait nié à plusieurs reprises – avaient pris le contrôle du lac Kivu, rendant la navigation impossible. Avec seulement un sac à dos à son actif, elle a fait un tour avec deux collègues défenseurs des droits de l’homme juste avant la chute de la ville.
En chemin, son mari n’arrêtait pas de lui envoyer des messages sur WhatsApp : Où es-tu? Êtes-vous d’accord? Pour ne pas l’inquiéter, elle répondit simplement : « Je vais bien. » Ce n’est que maintenant qu’elle s’autorise à revenir sur ce moment. « C’était une période effrayante… Les quelques-uns d’entre nous qui sont restés sont devenus comme une famille. »
À la frontière rwandaise, l’uniforme sur sa photo d’identité a attiré un regard plus dur. «Ils l’ont regardé et ont dit : ‘Vous êtes la police.’ J’ai répondu : « Non, je ne suis pas un policier ; Je suis correctionnel. Ils ont dit : « C’est pareil, vous êtes la police ! » » Elle a été mise à l’écart pour être interrogée. Des appels ont été lancés. Puis d’autres appels. Finalement, elle a été laissée passer.
Désormais en poste à Beni, ville toujours sous contrôle gouvernemental au Nord-Kivu, elle continue son travail au sein de l’équipe pénitentiaire de la MONUSCO. Le grand projet de prison qu’elle a supervisé à Kabare reste cependant en attente.
Olukemi Ibikunle (au centre) supervise la construction d’une prison dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC).
La reconnaissance d’un pionnier
Cette semaine, le travail de Kemi reçoit une reconnaissance internationale en tant que lauréate 2025 du Prix Trailblazer des Nations Unies pour les femmes agents de justice et pénitentiaires – un honneur qui célèbre les femmes qui brisent les barrières de genre dans les opérations de paix et redéfinissent ce à quoi ressemble le leadership derrière les murs des prisons.
Lorsque je l’ai rencontrée au siège de l’ONU, la veille de la cérémonie de mercredi, elle était déjà une sorte de célébrité locale.
Sur le chemin de notre entretien, un agent de sécurité de l’ONU – un compatriote yoruba – l’a immédiatement reconnue et est venu la féliciter.
Uvira : Où les déchets sont devenus du carburant
Les histoires dont elle parle sont antérieures à la tourmente du M23 – des projets tangibles qui ont discrètement transformé la vie derrière les barreaux.
L’un d’entre eux se démarque : le système de biogaz qu’elle a contribué à lancer en 2021 à la prison d’Uvira, au Sud-Kivu, où les déchets humains étaient transformés en gaz de cuisine. Les feux de cuisine ne se nourrissent plus des forêts. Les eaux usées ont cessé de jaillir des canalisations fissurées. « Plus d’odeur », dit-elle.
Son équipe a formé des agents et des détenus de longue durée pour entretenir le système. Après le retrait de la MONUSCO de la province, les livraisons d’eau se sont arrêtées ; un forage a été financé à distance et surveillé via des appels vidéo tremblants.
En 2024, elle a fait le trajet de huit heures pour constater par elle-même. « Ma joie était que le système de biogaz fonctionnait toujours… Trois ans et demi plus tard, tout était comme avant. »
Les agents lui ont dit que l’installation était « inviolable » et largement autonome. La phrase qui lui est restée est comme une bénédiction : « C’est la meilleure chose que vous ayez faite pour nous. »
Les détenues de Bukavu
Un autre souvenir – presque insignifiant en termes de coût mais immense en termes de signification – est venu de la prison de Bukavu, qui détenait 80 femmes et plus de 1 400 hommes. Chaque matin, des sacs de nourriture étaient distribués aux hommes. Les femmes, dit-elle, n’ont tout simplement « rien reçu ». Les responsables lui ont dit que leurs familles leur apportaient des repas et que des œuvres caritatives comblaient le vide. Pourquoi dépenser la ration de la prison pour eux ?
Et puis il y avait la cuisine elle-même : une ruine de suie et de poêles cassés, chaque femme cuisinant sur une seule flamme de charbon de bois. Kemi ne l’aurait pas. Elle a rassemblé 2 000 $ sur les lignes budgétaires restantes, a acheté des casseroles et des bols, a embauché un technicien et est restée à ses côtés jusqu’à ce que la cuisine reprenne son souffle.
Mais la véritable bataille était bureaucratique. Elle s’est adressée au chef de la prison et lui a fait valoir que le gouvernement fournissait de la nourriture à chaque prisonnier – et pas seulement aux hommes.
Pendant deux semaines consécutives, elle s’est présentée à 7 heures du matin pour s’assurer que les rations étaient partagées équitablement. Elle regarda les haricots être mesurés, faisant passer la portion d’un seau à deux, puis trois, jusqu’à ce que l’équité devienne une routine. « Finalement, dit-elle, c’est devenu une norme : le matin, les hommes reçoivent leur nourriture – et les femmes aussi. »
Si les femmes ne pouvaient pas la remercier à haute voix, elles le faisaient en silence – en levant un petit pouce sans un mot à chaque fois qu’elle entrait dans la cour.
Le coût du départ
Au cours de ses missions, Kemi ne cesse d’être mère, restant proche de ses enfants grâce à des appels vidéo longue distance. « Nous parlons sur WhatsApp », a-t-elle déclaré. « Sur le chemin de l’école, ils appellent toujours. Même sur mon vol ici, j’avais le Wi-Fi, donc j’ai pu communiquer avec eux. » À Lagos, son mari travaille à domicile, gardant ainsi le rythme familial intact.
Lorsqu’elle est partie pour la RDC, son fils de sept ans a joué la carte cool. « Tu pars demain ? D’accord, à bientôt », dit-il, tandis que sa sœur aînée s’accrochait à elle, lui demandant « cinq minutes de plus ».
Mais après le chaos de son évacuation de Bukavu, le garçon – aujourd’hui adolescent – a abandonné l’acte. Il a fondu en larmes. «Tu peux juste rentrer à la maison», lui dit-il. « Tu n’as pas besoin de travailler. Papa prendra soin de nous. » Elle a souri et lui a donné la seule réponse qu’elle connaît : » Ce n’est pas seulement une question d’argent. Il s’agit de faire quelque chose pour moi – et pour vous. «
La Vice-Secrétaire générale Amina J. Mohammed (à droite) remet le Prix Trailblazer au lauréat 2025, Olukemi Ibikunle, un agent pénitentiaire du Nigeria déployé à la MONUSCO.
Les moindres détails
Kemi revient souvent au même principe directeur : que la dignité réside dans les moindres détails – une porte naine, une marmite, une pipe qui n’éclate pas.
Ce mercredi à New York, elle est montée sur scène pour recevoir le Trailblazer Award. Pendant quelques minutes cérémoniales, elle était visible – les applaudissements, les photographies, les lignes citées.
Mais ensuite, elle retournera au travail tranquille qui la définit : le plan, le grand livre, les contrôles matinaux – et le travail long et acharné pour prouver, une cuisine réparée et une bibliothèque tranquille à la fois, que la paix commence derrière les murs de la prison.